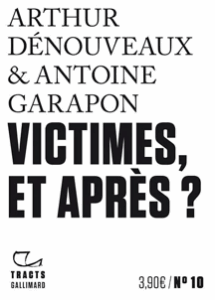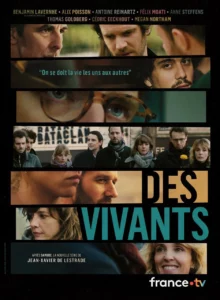Les attentats sont des violences intentionnelles, collectives et imprévisibles, qui visent à semer la peur et à rompre le sentiment de sécurité. Ils provoquent souvent un choc profond, autant dans le corps que dans l’esprit, chez les personnes directement touchées comme chez celles qui y assistent ou en entendent parler, sans oublier celles et ceux qui y perdent un proche ou qui ont un proche blessé.
En 2018, une étude montrait que parmi les victimes des attentats du 13 novembre, 18% présentaient un trouble de stress post-traumatique dans les six mois qui suivaient l’événement. Ce dossier propose des repères pour comprendre ce qui fait la spécificité de ces événements, leurs conséquences psychotraumatiques, et les moyens d’y faire face ou d’accompagner ceux qui en souffrent. Les attentats sont également à l’origine de troubles de stress post-traumatique et de deuils, à propos desquels vous trouverez des informations dans notre précédent dossier.
Ce dossier s’adresse aux personnes concernées, à leurs proches et aux professionnels susceptibles d’intervenir auprès d’elles.