Psychiatre au CHU de Montpellier, Hala Kerbage coordonne l’antenne enfants – adolescents du Centre régional du psychotraumatisme. Son activité allie clinique, recherche et formation, avec une attention particulière accordée aux ressources familiales et sociales des enfants et adolescents concernés par un trouble de stress post-traumatique.
« On ne naît pas résilient, on le devient »

À Montpellier, Hala Kerbage supervise l’accueil, l’évaluation et la prise en charge des enfants et adolescents exposés à un événement traumatique, avec une équipe pluridisciplinaire. L’évaluation proposée est standardisée et ne se limite pas au repérage des symptômes post-traumatiques mais inclut aussi une évaluation des facteurs de risque et de protection propres à l’enfant et à son environnement.
Elle distingue deux axes dans l’intervention : un travail avec les parents, centré sur le dépistage de symptômes post-traumatiques chez les parents eux-mêmes, le renforcement de leurs compétences de soutien à l’enfant ; et un travail avec l’enfant pour identifier les symptômes post-traumatiques et lui transmettre, avec l’aide de l’adulte, des techniques de régulation adaptées à son âge dans un premier temps puis des thérapies spécialisées validées pour le trouble de stress post-traumatique dans un deuxième temps.
« On ne naît pas résilient, on le devient », résume-t-elle. Cette idée guide l’ensemble de la prise en charge, depuis la psychoéducation ou les séances de stabilisation jusqu’aux thérapies, en fonction de ce qui est jugé pertinent après l’évaluation. Le soutien social, en particulier, fait l’objet d’un travail concret avec les familles. L’objectif n’est pas de leur dire juste de s’entourer, mais de les aider à identifier les personnes et les lieux ressources, et à renouer des liens utiles, de faire du soutien social un objectif thérapeutique.
Apprendre à ne pas savoir à la place de l’autre

Avant de rejoindre le CHU de Montpellier, Hala Kerbage a travaillé plusieurs années au Liban, notamment avec des ONG internationales. Elle est intervenue auprès de réfugiés syriens ayant survécu à des camps de torture, de Palestiniens déplacés, et a mené une mission à Erbil, en Irak, auprès de femmes yézidies victimes de génocide. Ces expériences l’ont amenée à remettre en question certaines postures descendantes.
« Après certaines horreurs, on ne peut pas arriver en disant : voilà la thérapie qu’il vous faut. » Elle insiste sur la nécessité d’écouter ce que les personnes ont vécu, ce qu’elles souhaitent, ce dont elles ont réellement besoin. Certaines refusent d’être qualifiées de traumatisées, et se définissent comme survivantes, parfois comme résistantes. Pour elle, cela ne traduit ni un manque de compréhension ni une méconnaissance de la psychiatrie, mais une autre manière de donner sens à l’expérience.
Penser le soin à partir du lien
De cette expérience découle une conception du soin guidée par un souci d’humilité envers les patients. Pour elle, l’expertise ne peut être dissociée de l’attention portée au vécu. Elle insiste sur la nécessité de laisser aux personnes un pouvoir d’agir sur leur trajectoire. Dans les suites d’un traumatisme, ce qui compte, c’est de préserver l’agentivité. « Ce qui fait le plus de mal, c’est de se sentir impuissant. Il faut que les patients restent auteurs de leur histoire. »
Une intervention précoce centrée sur l’enfant et ses proches
Hala Kerbage consacre également une partie de son temps à la recherche. Elle pilote actuellement un essai randomisé contrôlé sur une intervention post-traumatique précoce, pouvant être implémentée dans les trois mois suivant l’exposition à un événement traumatique, structurée autour de deux axes : le renforcement de la communication parents – enfants, du soutien parental, et de la santé mentale parentale, et l’acquisition de compétences de stabilisation des symptômes post-traumatiques de l’enfant selon son âge, en coordination avec les parents. L’originalité de cette intervention est qu’elle cible non seulement l’enfant mais aussi ses parents et la répercussion de l’événement traumatique sur ses parents. Elle en présentera les principes lors du webinaire organisé par le Cn2r le 27 mai.
« Ce n’est pas une thérapie spécialisée de réexposition car on est encore à un stade précoce, mais un moyen de retrouver un contrôle sur les symptômes, et de travailler sur les facteurs de protection pour prévenir l'installation de trouble de stress post traumatique après une exposition traumatique. »
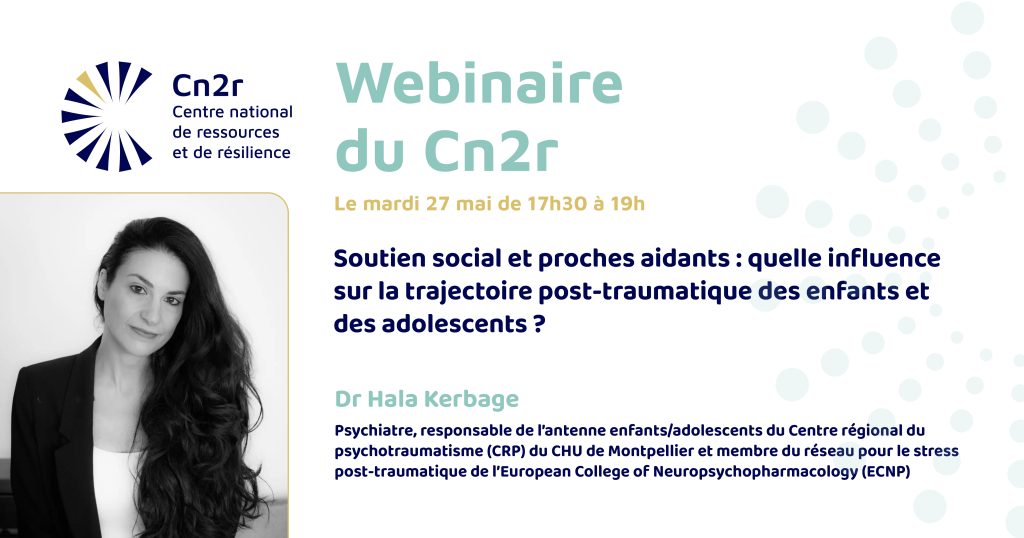
« Le psychotrauma doit être l’affaire de tous »
« Le psychotrauma, ce ne peut pas être un domaine réservé aux experts », souligne-t-elle. À ses yeux, chaque professionnel de santé doit pouvoir accueillir la parole d’un patient, la valider, informer sur les symptômes et soutenir les familles dans les premières étapes. Cette nécessaire culture commune du soin suppose de former les médecins généralistes, les sages-femmes, les soignants de PMI, et d’ouvrir les thérapies validées à d’autres métiers, comme les infirmiers formés.
Une lecture marquante, entre mémoire et violence
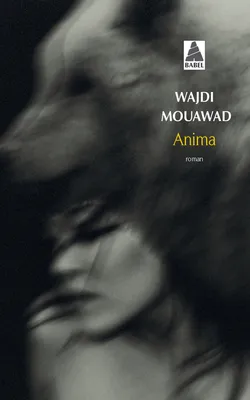
Parmi les œuvres qui comptent pour elle, Hala Kerbage cite Anima, de Wajdi Mouawad. Un roman marquant, autant pour sa forme — chaque chapitre est raconté du point de vue d’un animal — que pour ce qu’il traverse : la violence, la mémoire, l’identité. « Quand on travaille dans le trauma, on entend parfois des choses si dures qu’on se demande comment les gens tiennent. Ce livre, il ne donne pas de réponses, mais il accompagne cette question. »
D’origine libanaise, elle a aussi été frappée par ce que le texte dit du silence : « J’ai grandi dans un pays marqué par la guerre, mais où cette guerre n’est presque jamais racontée. Il y a une forme d’amnésie collective. Et ce silence, il continue de travailler les gens. »
« La résilience, ce n’est pas un trait inhérent à l’individu »
Dans les années à venir, Hala Kerbage souhaite consolider le fonctionnement du Centre régional du psychotraumatisme enfants – adolescents, en s’appuyant sur des outils d’évaluation rigoureux, des soins structurés et le développement de formations spécifiques. Elle travaille à la diffusion de thérapies validées, comme l’exposition prolongée, et veille à renforcer les compétences des professionnels de première ligne, notamment en stabilisation et en psychoéducation.
Mais pour elle, penser la résilience suppose d’élargir le regard au-delà de l’individu. « On ne peut pas faire reposer la rémission uniquement sur l’enfant ou sa famille. Il faut aussi pouvoir dire que les inégalités sociales, les conditions de vie, les violences systémiques ont un impact. » Pour elle, renforcer l’accès aux soins ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir nommer ce qui, dans l’environnement social, économique ou politique, contribue à la souffrance. « On ne peut pas faire porter uniquement la responsabilité de la rémission sur les épaules de l’individu, et notamment de l’enfant. Il faut aussi pouvoir dire que les inégalités sociales, la précarité, les violences systémiques ont une incidence. »



