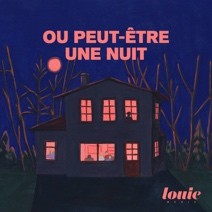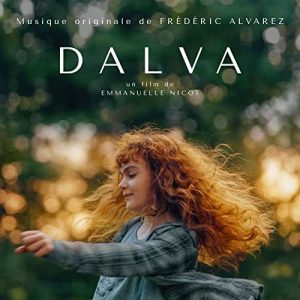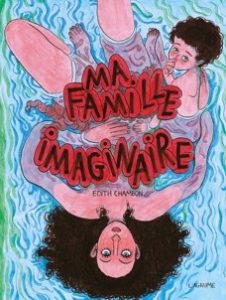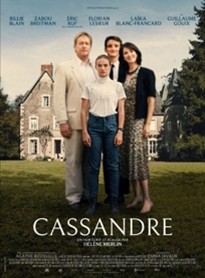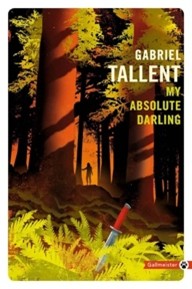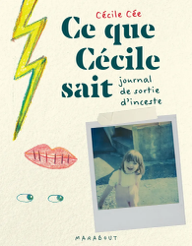Parmi les violences sexuelles, celles commises dans le cadre familial comptent parmi les plus traumatisantes. Elles peuvent survenir dans l’enfance ou l’adolescence, dans un climat d’emprise et de secret. Ces violences incestueuses, qu’elles soient qualifiées juridiquement d’inceste ou qu’elles s’inscrivent dans un contexte familial élargi, sont encore aujourd’hui insuffisamment reconnues et
accompagnées.
Ce dossier propose des repères pour comprendre ce que recouvre la notion d’inceste subi par des mineurs, en quoi ces violences diffèrent d’autres agressions sexuelles, quels en sont les impacts psychotraumatiques, et comment il est possible de se rétablir d’un psychotrauma potentiellement associé. Il s’adresse à toutes les personnes concernées, à leurs proches, ainsi qu’aux professionnels qui peuvent être amenés à repérer, accompagner ou orienter des victimes.